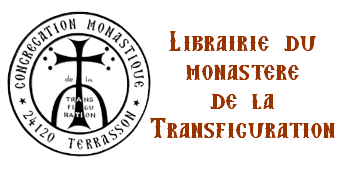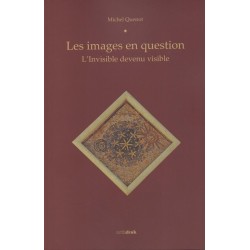Aucun produit
Les prix sont TTC
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Catégories
- Ventes au profit de la construction de la nouvelle église du monastère
-
Livres
- Oeuvre de l'archimandrite Aimilianos
- Oeuvres de l'Archimandrite Elie
- Enseignements spirituels
- Vies de saints
- Orthodoxie
- Ouvrages de prière
- Oeuvre de l'archimandrite Placide DESEILLE
- Livres pour Enfants et Adolescents
- Evergetinos
- Ouvrages divers
- Iconographie
- Livres d'occasion
- Romans
- Calendriers
- Collection Sources Chrétiennes
- Livres en langue étrangère ou bilingues
- Périodiques
- Etude biblique de la Septante
- CD/DVD
- Reproduction d'icônes
- Cartes de voeux
- Produits du monastère
- Articles religieux
- Conférences
- Nouveaux
-

L'âme et la résurrection - Dialogue avec sa sœur Macrine - Occasion
Livre d'occasion en très bon état :...
18,00 € -10% 20,00 €

Les images en question - L’invisible devenu visible
Le lecteur accoutumé à l’œuvre abondante du Père Michel Quenot ne trouvera pas, dans ce récent ouvrage, la riche iconographie à laquelle il est accoutumé. Mais ce n’est pas tant cela qui risque de le déconcerter que le contenu un tantinet confus et embrouillé des quatre-vingt premières pages.
On comprend bien ce qu’a été l’intention de ce long développement : nous rendre attentifs à la place de l’image dans la vie sociale, politique, religieuse et psychique, insister sur la continuité historique d’une telle prégnance, montrer l’aggravation de cette mainmise sur notre imaginaire, qui se joue au sein des pouvoirs contemporains, grâce à tous ces savoir-faire, rendus davantage pernicieux par l’appel qu’ils font aux apports des « sciences humaines ». Ces pouvoirs se jouent de nous, dans le vaste océan de la « communication », avec leurs publicités, leurs propagandes et leur fabrication d’un imaginaire collectif. Vaste sujet, trop vaste sans doute : dans ces dizaines de pages qui se confrontent à ce défi, nous ne trouvons, trop souvent, qu’une suite d’affirmations générales, voire incantatoires, là où il eut fallu distinguer entre imagination personnelle et imaginaire collectif puis, au sein de ce dernier, entre ce qui s’ancre dans une pratique commune héritée d’une histoire, et ce qui est l’effet d’une claire propagande, explicitement réfléchie et organisée. Tout se mêle, certes, au sein du réel, mais le propre d’une analyse consiste à poser des distinctions dans ce qui s’enchevêtre, dans l’espoir d’en faciliter une compréhension.
Mais, une fois passé cet exorde quelque peu longuet, les approximations brumeuses s’évaporent, au profit d’une lecture stimulante de l’histoire de l’art occidental non point à l’aune du credo « progressiste » que nous rencontrons d’ordinaire en tout manuel d’histoire de l’art, mais à la lumière du sens de l’icône. Michel Quenot nous montre alors, avec compétence et clarté, comment cette histoire de l’art, de la peinture et de la sculpture en particulier, s’est mise à basculer à partir du XIII -ème siècle, en se convertissant à cet anthropocentrisme si caractéristique de la modernité, et qu’il est convenu d’appeler « humanisme ». Il expose comment se délite graduellement, chez des artistes fondateurs d’un art nouveau, depuis un Giotto ou un Cimabue jusqu’à un Raphaël, un sens du sacré, du mystère, de la Création. En mettant, par l’invention de la perspective et par la primauté accordée au visible, l’homme au centre du monde, l’artiste signe la récusation de la foi chrétienne : la divino-humanité révélée et manifestée en Christ, va peu à peu se retrouver reléguée dans quelque nécropole des superstitions « moyenâgeuses ». Or, il n’y a pas dans ces orientations artistiques de la soi-disant Renaissance, la moindre libération ni la moindre avancée vers une autonomie humaine réhabilitée. La vocation de l’homme consiste, en effet, à retrouver sa ressemblance avec son Créateur, à se laisser transfigurer par les Energies Incréées, et tel est bien le sens théologique de l’Icône. Le rejet moderne de cet art liturgique induira une idolâtrie mortifère de l’humanité. Ainsi que l’écrit l’auteur : « Perdre l’image de Dieu équivaut pour l’homme à perdre sa propre image. Le refus de Dieu conduit au refus de l’homme. L’humanisme athée s’avère une illusion ! »